L’art nous rend-t-il plus vivant ? introduction de Laurent GRZYBOWSKI
Depuis l’époque préhistorique, l’être humain est un artiste dans l’âme. Des grottes de Lascaux aux cathédrales gothiques, des hiéroglyphes égyptiens aux temples incas, des statues de l’île de Pâques aux sept merveilles du monde, en passant par l’Alhambra de Grenade, d’innombrables œuvres picturales et architecturales témoignent de la beauté et de la richesse de notre histoire. Comment ne pas citer également les chants du monde ou les œuvres musicales de Mozart ou de Jean-Sébastien Bach ; les écrits d’Ibn Arabi ou de Victor Hugo, des mystiques, des poètes, des écrivains ; les créations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques qui ont marqué notre histoire, sans oublier la photographie, la calligraphie, la bande dessinée, la sculpture ou l’art de la mosaïque.
L’occasion pour moi de remercier deux artistes présents parmi nous ce matin (deux artistes parmi d’autres) et tout au long du week-end. Ils animeront d’ailleurs chacun de leur côté un atelier : Chouki Derrouiche, sculpteur musulman ouvert à toutes les traditions spirituelles, qui sont pour lui autant de sources d’inspiration, et Sr Samuelle, religieuse catholique, mosaïste. Un grand merci à elle, à eux, d’avoir accepté d’exposer quelques-unes de leurs œuvres. Il y a un autre artiste que j’aimerais d’ores et déjà remercier : José Gurdak, pianiste et compositeur de musique, qui animera lui aussi un atelier de « sculpture musicale » avec Edith Fortin, chanteuse et psychomotricienne. Merci à eux !
L’art donne de l’éclat à la vie car avant d’être une activité culturelle, il est une activité de l’esprit. « Puissance spirituelle, il est le langage de l’âme », affirmait le peintre Kandinsky. Il éveille et transforme notre être intérieur. Au centre de toutes les religions, il incarne la puissance de représentation qui rapproche les humains des dieux ou de Dieu. « Tremplin vers l’Absolu », selon Hegel, il est aussi un remède de la vie affectée par les troubles, les malheurs et les angoisses de l’existence. Parce qu’il donne sens à notre vie et nous permet de goûter autrement notre quotidien, il vient souvent nous relever.
En novembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé publiait un rapport qui affirmait pour la première fois l’impact bénéfique de l’art sur notre santé physique et mentale. Reposant sur 900 articles scientifiques, il stipulait que les activités artistiques étaient déterminantes pour notre épanouissement depuis notre conception à l’âge avancé, et devraient être généralisées aux cotés des protocoles thérapeutiques en milieu hospitalier, dans l’éducation mais aussi dans la vie de tous les jours pour améliorer notre bien-être.
Un an plus tard, le monde entier faisait face à l’épidémie de la Covid-19. Une crise qui provoqua des dégâts sanitaires, économiques et sociaux sans précédent et qui affecta durablement la santé mentale et psychique de beaucoup de nos concitoyens. « En limitant l’accès à l’art, on tue ce qui donne envie de vivre », explique le neurologue Pierre Lemarquis auteur d’un livre intitulé « L’art qui guérit ». En s’appuyant sur de nombreux exemples de l’histoire de l’art, de la philosophie et de la recherche médicale, l’auteur explique les étonnants pouvoirs de l’art sur notre bien-être, sur notre développement intellectuel et même sur certaines pathologies.
Selon la formule consacrée, l’art ‘sculpte et caresse’ notre cerveau. Car, pour ce neurologue, nous avons deux cerveaux. Une partie qui capte les informations qui nous entourent, qui les compare à ce que l’on a en mémoire, et avec laquelle on décide d’agir sur le monde en fonction des informations qu’on vient de recevoir. On agit pour rester en vie, ce que pourrait aussi bien faire un ordinateur. Mais, dans notre cerveau, nous avons une autre partie, moins rationnelle et plus archaïque, celle du plaisir et de la récompense.
L’art agit sur les deux : il sert à élargir notre état d’esprit, à nous apprendre de nouvelles choses, il agit sur la plasticité cérébrale et donc sculpte notre cerveau. Mais il agit aussi sur nos émotions, il caresse notre cerveau et stimule les hormones responsables du plaisir et de l’attachement : la dopamine, la sérotonine, l’ocytocine et la morphine endogène. Les 4 hormones du bonheur. Hormones que l’on active aussi en pratiquant un sport ou en se faisant des câlins. Or, ces hormones nous donnent envie de vivre. Les effets bénéfiques de l’art sont avérés depuis l’Antiquité. Dans la Grèce antique, Aristote évoque la libération des passions du spectateur grâce aux acteurs de théâtre. C’est ce qu’on appelle la catharsis. Notre ami metteur en scène Laurent Poncelet pourra nous en parler.
Retrouver le goût de vivre, c’est ce qui a fait des arts – et notamment de la musique – les activités parmi les plus plébiscitées au tout début de la crise sanitaire, et notamment pendant le premier confinement. On a même parlé de pandémie musicale, alors que se constituaient spontanément des formations musicales entre membres de familles confinées, voisins ou musiciens privés de scène par le biais du numérique. Plusieurs études ont démontré l’importance de la musique pour de nombreuses personnes pendant le premier confinement, notamment celle de l’Université McGill de Montréal, selon laquelle la musique est arrivée à la première place des activités pratiquées, avant la conversation avec des amis ou la cuisine.
« Non seulement la musique a été plus fréquemment citée comme activité refuge pour lutter contre le stress pendant le confinement, mais plus la pandémie avait un impact sur les gens, à cause de la perte d’un proche, des problèmes financiers, ou de l’isolement, plus ils se tournaient vers la musique, et moins ils étaient déprimés, » explique Emmanuel Bigand, neuropsychologue à l’Université de Bourgogne. « La musique est une caresse. Elle peut réguler notre humeur, modifier la biochimie de notre cerveau, et notamment réguler la sécrétion du cortisol, hormone du stress. On peut vraiment reprendre le courage et se sentir revitalisé. La musique est une super médecine non-invasive, » résume le spécialiste.
Et si la musique a rencontré une telle adhésion pendant la crise du Covid, c’est aussi parce qu’elle a répondu à nos besoins fondamentaux de connexion avec les autres. « Faire de la musique avec d’autres permet à nos cerveaux de se synchroniser. Cette synchronisation change la relation sociale, l’empathie que l’on a avec l’autre, la personne nous parait beaucoup plus sympathique et on rentre dans une relation de collaboration. Cette relation d’attachement à l’autre est un besoin de tous les instants de la vie de l’être humain, mais s’accentue en période de crise. Le fait de se synchroniser avec les autres brise notre isolement et nous redonne confiance, » conclut le chercheur.
J’échangeais hier dans la voiture avec Christèle Daire, du Secours catholique qui, me faisant part de son expérience avec les personnes en précarité ou cabossées par la vie qu’elle rencontre, me disait que la création artistique, en l’occurrence l’expression théâtrale, était un formidable moyen de découvrir les trésors enfouis en soi. L’activité artistique nous permet de devenir plus authentique. Au contact de la matière, qu’il s’agisse d’un instrument de musique, d’une palette de couleurs, d’un burin, d’un pinceau, d’une pierre ou d’un morceau de terre, d’un stylo ou d’un appareil photo, nous découvrons qu’il est impossible de tricher avec soi-même. L’art nous permet finalement de cultiver notre intériorité. Et d’exprimer à la fois nos rêves et nos révoltes. Les rêves et les révoltes, nos désirs les plus profonds et nos cris de détresse, tels sont les deux piliers de l’engagement. Pourraient-ils être aussi les deux piliers de l’acte créateur ?
Révélatrice de notre humanité, l’expression artistique permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. L’art n’a pas de pays d’origine, pas de religion, il est universel. Il rapproche et unit les femmes et les hommes du monde entier. Nul besoin de connaître une langue étrangère pour décrypter, interpréter et savourer une œuvre d’art. Elle parle d’elle-même. Elle ne dira pas la même chose aux uns, aux unes et aux autres, mais elle parlera. Peut-être parce qu’elle touche à ce qu’il y a de plus humain en nous. Je me souviens de cet entretien passionnant que j’ai eu il y a quelques années avec un grand paléoanthropologue, Pascal Picq, auteur de nombreux ouvrages sur la question.
Dans cet entretien, il m’expliquait que le propre de l’être humain n’était ni le rire, ni l’outil, mais sa capacité d’innovation et d’imagination. Je le cite : « Ce ne sont pas les inventions qui caractérisent le génie humain, mais la manière de les articuler. C’est le principe même de l’innovation. L’être humain est devenu humain en intégrant ses inventions dans une synthèse créatrice et en développant des capacités d’innovation transformatrice. Capacité aussi à se transformer lui-même, à modifier son apparence, à agir sur son corps : la cosmétique, les tatouages, les scarifications, l’usage des parures et des colorants sont des activités proprement humaines. Avec lui, l’imagination devient une force de transformation » (…) « Ce qui nous distingue des grands singes, ce ne sont pas les outils, c’est notre imaginaire. Une formidable force de transformation, capable d’inventer l’avenir. » Incroyable mais vrai ! L’être humain est capable de faire de son corps, de sa vie, de son environnement une œuvre d’art…
Chemin vers soi, chemin vers l’autre, l’art peut nous aider à créer des liens et à vivre ensemble. Il peut aussi contribuer à nous guérir, à nous remettre debout. En ce sens, peut-on dire qu’il nous rend plus vivant ? L’humanité pourrait-elle vivre ou survivre sans expression artistique ? Qu’en disent les grandes traditions religieuses, à travers leurs rites, leurs textes et leurs pratiques ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de ce week-end. En commençant ce matin par un dialogue des pensées et des écritures. Je vous souhaite un excellent interfestival des religions et des convictions. Que ce week-end soit pour chacune et chacun d’entre vous un moment de renouvellement, un moment d’émerveillement, un moment plein d’émotions, intense et vrai, placé sous le signe de la joie ! Je vous remercie pour votre attention.
Laurent Grzybowski
réécouter les interventions : https://www.abbaye-st-jacut.com/mediatheque
Le festival en photos :
2024-01-27a, Inter festival des Religions &Convictions https://photos.app.goo.gl/yWuZsCLCBrvysUSK8
2024-01-27a, Inter festival des Religions &Convictions https://photos.app.goo.gl/n1dozF34h4GhsJATA
2024-01-27b, Inter festival des Religions Saint-Jacut22 https://photos.app.goo.gl/ueJMnSHbZSsCqbPW8
2024-01-27.28c, Inter festival Saint-Jacut22 https://photos.app.goo.gl/M6kboJ5iScVTkGnv7

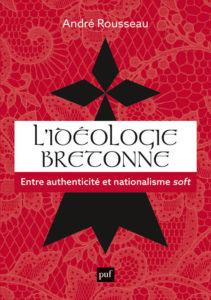
 jusqu’à présent :
jusqu’à présent :