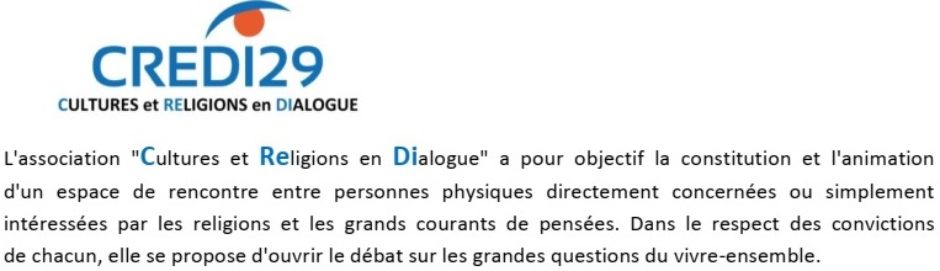Vingt ans et après
Je ne vais pas ajouter à ce que Jean-Pierre a rappelé, mais soulever une question nécessaire et y apporter une réponse
– Pourquoi voulons-nous continuer ? et pour qui ?
1 – Continuer oui mais en réfléchissant à ce que nous faisons…
Je pense que la question est nécessaire : ne pas se la poser c’est transformer une idée en coutume et en habitude…. « La mémoire et l’habitude sont les fourriers de la mort » disait Charles Péguy. Comment ne pas devenir une institution ? Nombre d’associations « à but non lucratif » se sont retrouvées lucratives et en quête de but… ce n’est pas ce qui nous menace mais …
2 – La pertinence de poursuivre
Je réponds à cette question en me référant au titre de ce livre d’Hartmut Rosa, (Pourquoi la démocratie a besoin de la religion) édité en 2023. On peut mettre le singulier de religion au pluriel bien entendu…
Rosa est un sociologue allemand né en 1965. Ce livre reprend une conférence donnée aux évêques allemands… en 2022…
Il commence par résumer les thèses de deux de ses livres
– Accélération – une critique sociale du temps (paru en 2010)
– Résonnance – une sociologie de la relation au monde (2018)
L’économie mondialisée et financiarisée, explique le premier livre, est comparable à un cheval que son cavalier a lancé au galop… il devient impossible d’en descendre…La croissance des produits à l’échelle de la planète a obligé à construire des porte-conteneurs, fait rouler des camions et fonctionner des chaînes de distributeurs…La croissance demande de la croissance. Pas la peine de vous rappeler les questions de la dette qui résulte de cette fuite en avant ; ou celle du changement climatique qui en est la conséquence.
Et quel est le sens de tout ceci ? C’est là que les religions pointent leur nez…
…et que le second livre apparaît une bonne ressource.
Résonance ? C’est un terme musical : un musicien sait qu’un son ne résonne pas seul ; il a des harmoniques. La démocratie n’est pas seulement un Etat, la police et le percepteur mais aussi des bureaux de vote et un roman national ; une nation disait Ernest Renan, sollicite un plébiscite de tous les jours. Mais c’est surtout la capacité à chanter la même partition … La résonnance c’est partager la même émotion collective devant une forêt qui brûle et devant une cathédrale dans la même cas. Or cela n’arrive que rarement… Ou artificiellement comme les jeux Olympiques…et ici le feu est un feu de paille comme nous le constatons d’un an après ! mais nous avons pu entendre aussi que religions et sport pouvaient être mis en résonance… : dans certaines conditions on retrouve sens aux événements et ce sens est partagé.
Les religions auraient-elles une expérience à faire valoir dans la crise politique qui est la nôtre ?
Faire un à plusieurs. E pluribus unum c’est une formule que les théologiens appliquent à l’Eglise ; l’Islam c’est la communauté ; et le judaïsme : Ecoute, Israël ! Abraham quitte son pays Et pour les trois : l’Autre absolu comme seule boussole.
Face au constat résume à l’instant, et développé dans les deux premiers tiers de la conférence, une solution s’impose, selon Hartmut Rosa : s’arrêter et tendre l’oreille (aufhören). Si certaines et certains cherchent cette « résonance » dans la sylvothérapie ou l’astrologie, l’auteur estime que les religions apportent des expériences et des ressources solides. On sait ainsi que les monastères sont une préfiguration de la démocratie ; l’une de leurs règles est que « ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde ».
En posant les religions comme nécessaires ou utiles la démocratie, Rosa ouvre ses propos en reprenant la prière de Salomon : « Donne-moi un cœur qui écoute » (1 Rois 3, 9). Voilà, nous dit-il, l’apport possible des traditions religieuses au profit d’une société à bout de souffle.
Il existe bien des frontières entre religions et une perte de crédibilité de toutes les religions, (cf. la conférence de Jean-Marie Donegani)
-> Mais Rosa n’est pas le seul à contester l’idée que c’en est fini avec les religions. Que les frontières entre une culture sécularisée ou laïque et les religions ne sont pas infranchissables si on cherche la résonance…
-> Les relations horizontales (famille, amis, région, patrie) sont un registre indispensable, mais nous somme aussi reliés au monde et depuis la modernité nous en faisons un objet… et il faut réintégrer la nature, dans la vie démocratique… réintroduire de la réciprocité avec le monde…les arbres, les animaux…Cf. Conférence de Frédéric Rognon sur les religions et l’écologie.
-> La résonance n’est pas un phénomène seulement psychologique – c’est pourquoi, d’ailleurs, la méditation de pleine conscience et toutes les disciplines subjectives ne sont pas suffisantes pour y accéder. Elles demeurent peut-être nombriliques Il faut aussi que quelque chose provienne du monde.
L’individu moderne a le besoin urgent de retrouver des « résonances », de s’arrêter pour écouter une autre voix, pour accepter la rencontre avec autrui et la transformation qu’elle induit. C’est là que la religion peut intervenir dans la mesure où, par ses pratiques, elle témoigne d’une ouverture à l’altérité. La démocratie ne se limite pas à exprimer un vote, mais à être entendu, un aspect souvent négligé aujourd’hui, créant une déconnexion des élites. La pratique des religions, en tant que modèles de résonance, refus du mépris (affect qui ronge le plus la société française au moins), peut contribuer à revitaliser les institutions politiques. Rosa embellit sans doute, mais l’idée peut faire son chemin.
3 – conclusion ce que nous devons poursuivre et parachever
Les conférences par leur méthode, leurs sujets et les conférenciers, illustrent que pour CREDI le dialogue, ne vise pas d’abord à gommer les préjugés réciproques et à prier ensemble pour que cela arrive. Ceci c’est le dialogue des institutions et c’est évidemment très bien… Ce que nous faisons et pourrions faire mieux sans doute, pratiquer le changement de point de vue. La reconnaissance c’est l’acceptation des différences… La résonance c’est faire quelque chose de cette reconnaissance…
Un militant de la ligue de l’enseignement, un imam et le directeur d’un lycée catholique ont chacun des émotions particulières. Le premier hérite d’une victoire : on peut ne pas croire ; et la société est dotée d’une autonomie. Le second cherche à surmonter des préjugés. Le troisième défend le caractère propre et demande si l’autonomie suffit à fonder les choix…
Mais le premier se rend-il compte qu’il prive de connaissances et d’émotion ? Le second parvient-il à s’inscrire dans la culture séculière et la démocratie ? Le troisième parvient-il à rendre audible le caractère propre au catholicisme ? comment l’applique-t-il aux musulmans qu’il scolarise ?